« Face au Covid, les communes ont un rôle essentiel à jouer »
L’épidémie de Covid a été l’événement marquant de ce printemps et de cet été 2020. Elle sera toujours parmi nous cet automne. Comment vivre avec le Covid ? Comment se protéger et protéger les autres tout en continuant à vivre « normalement » ? Comment agir au niveau local ? Ecolo Grez-Doiceau a interrogé trois experts, trois Gréziens. Yves Coppieters, professeur de santé publique et épidémiologiste à l’ULB, Leila Belkhir, infectiologue à la clinique Saint-Luc et Jean-Louis Lamboray, médecin, un des créateurs d’Onusida et figure de proue de l’Agora dans notre commune.
Leila Belkhir et Yves Coppieters, en l’espace de quelques mois, vous êtes devenus des personnages publics. Comment vivez-vous cette notoriété soudaine ?
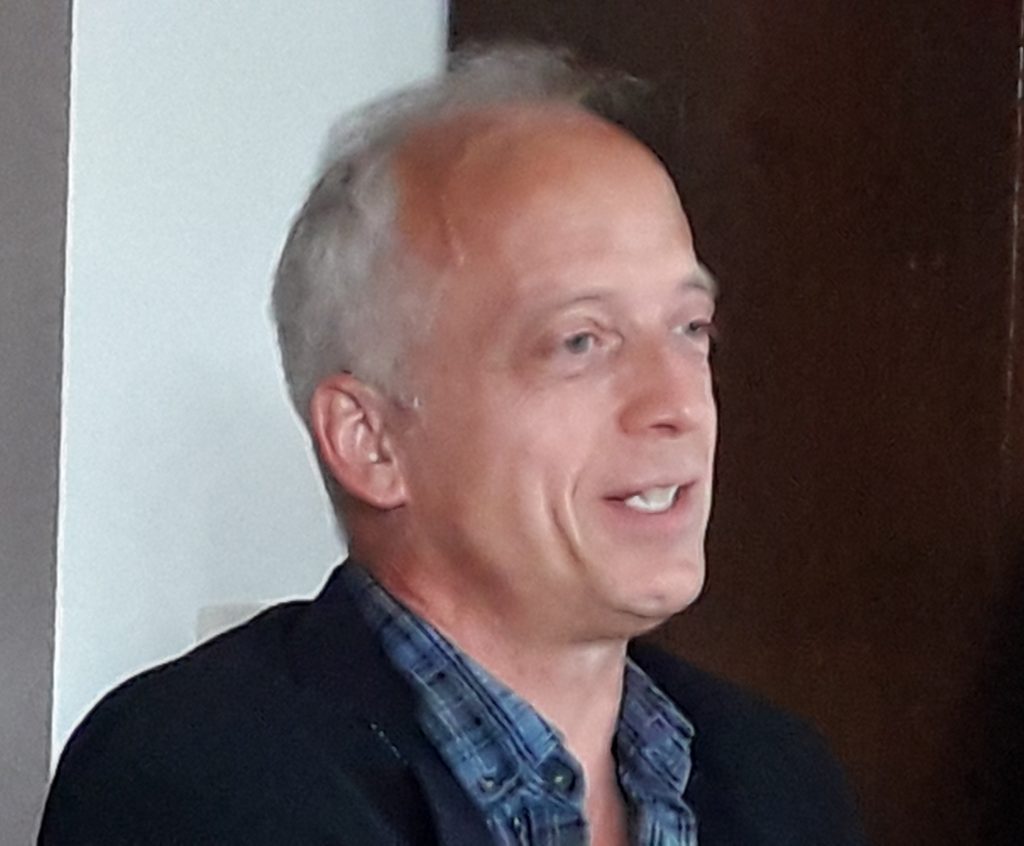 Yves Coppieters : Cela s’intègre dans mon travail de santé publique qui est basé sur la prévention et sur la communication en santé. Nous avons des outils en santé publique pour être à l’aise dans ce genre d’exercice. La notoriété, je ne la sens pas spécifiquement si ce n’est par des messages de personnes qui m’interpellent, toujours en lien avec le Covid. Mais cela s’intègre dans ma vie professionnelle et je n’ai donc pas l’impression de vivre quelque chose de particulier.
Yves Coppieters : Cela s’intègre dans mon travail de santé publique qui est basé sur la prévention et sur la communication en santé. Nous avons des outils en santé publique pour être à l’aise dans ce genre d’exercice. La notoriété, je ne la sens pas spécifiquement si ce n’est par des messages de personnes qui m’interpellent, toujours en lien avec le Covid. Mais cela s’intègre dans ma vie professionnelle et je n’ai donc pas l’impression de vivre quelque chose de particulier.
Leila Belkhir: Pour moi, c’est différent. À part le fait que j’aime bien parler et enseigner, il y a tout de même un regard qui a changé au niveau des patients. Des patients disent m’avoir vu à la télé et ça me met un peu mal à l’aise. J’ai reçu aussi beaucoup de messages et ça, c’est plutôt une belle surprise parce que la plupart témoignent de manière très bienveillante ou me remercient pour les explications que j’ai données. C’est donc plutôt une expérience positive.
Pour vous Yves Coppieters, cela s’apparente parfois à un exercice d’équilibriste. Lorsqu’au JT de 13 h sur le plateau de la RTBF, vous devez réagir à chaud sur des chiffres, des études, des déclarations politiques…
YC : Cela nécessite une mise à jour continue de l’information. L’information va très vite et au moment où on l’apprend, elle est déjà relayée dans les médias. Il faut aller plus loin que cette information et essayer de faire passer une évidence scientifique. L’exercice est compliqué parce que chaque fois le temps est très court pour préparer un commentaire.
Avec le déconfinement, on constate des approches et donc des avis parfois divergents de la part des différents experts sollicités par les médias. Cela peut déboussoler le public. Le problème vient sans doute aussi, que beaucoup d’inconnues entourent encore ce virus. Est-ce difficile d’avouer son ignorance ?
 LB : Oui, il y a des choses qu’on ignore, mais le problème vient aussi des médias qui ont tendance à relayer des bribes d’articles et d’en faire des gros titres alors qu’il s’agit finalement de données qui demandent à être confirmées et qu’il faut prendre du recul. Parfois, les journalistes veulent absolument mettre en exergue une info alors qu’elle n’est pas fondée. Ce fut le cas lorsqu’on a détecté chez certains patients un peu de SARS-CoV dans le sperme. On voulait me faire dire qu’il s’agissait d’une nouvelle maladie sexuellement transmissible ! Les médias veulent informer, toujours, tout le temps, mais à la fin trop d’informations tue l’information.
LB : Oui, il y a des choses qu’on ignore, mais le problème vient aussi des médias qui ont tendance à relayer des bribes d’articles et d’en faire des gros titres alors qu’il s’agit finalement de données qui demandent à être confirmées et qu’il faut prendre du recul. Parfois, les journalistes veulent absolument mettre en exergue une info alors qu’elle n’est pas fondée. Ce fut le cas lorsqu’on a détecté chez certains patients un peu de SARS-CoV dans le sperme. On voulait me faire dire qu’il s’agissait d’une nouvelle maladie sexuellement transmissible ! Les médias veulent informer, toujours, tout le temps, mais à la fin trop d’informations tue l’information.
C’est anxiogène ?
LB : Oui et ce l’est pour beaucoup de personnes. D’un côté, il faut continuer à dire au public qu’il faut faire attention mais les gens ont aussi besoin d’un peu souffler. Cela devient contreproductif de vouloir faire du Covid le premier titre des infos tous les jours, depuis des mois.
Depuis le déconfinement, vous devez, en tant qu’experts, à la fois continuer à mettre en garde, mais vous devez aussi limiter une anxiété de plus en plus présente dans la population ?
YC : Attention : nous sommes tout de même à un moment où l’épidémie est énorme à l’échelle mondiale. La situation n’est plus sous contrôle dans certains pays comme le Brésil, l’Inde… On est très fort protégé en Europe en matière de gestion de l’épidémie et nous sommes à la fin de la première vague mais ce n’est pas le cas autour de nous. Doit-on pour autant maintenir les Belges dans l’anxiété ? Non, si ce n’est qu’on voyage, et franchement, sans rentrer dans un scénario catastrophe, les modèles montrent que les rebonds seront là avant la fin de l’été parce que les problèmes s’accélèrent dans le reste du monde. On peut laisser les gens passer leur été tranquillement et continuer à donner une communication de base pour garder les gestes barrière qui maintiendraient le contrôle de la transmission. Si la situation dans le monde était comme celle qui prévaut en Belgique, on pourrait dire : ok, on se lave les mains et ça va marcher.
« Une bonne communication vers le public est la clé du succès »
LB : Je n’analyse pas les chiffres comme Yves mais je pense tout de même que trop d’anxiété, c’est contreproductif. Je le vois à l’hôpital. Le déconfinement est très compliqué, bien plus que le confinement. Parce qu’il faut maintenir les gestes barrière et que certains commencent à les relâcher. Mais, en même temps, je sens une grande anxiété chez les gens comme parmi les membres du personnel soignant, qui voudraient voir tout le monde avec des masques ffp2 et tous les équipements de protection. J’’ai beaucoup de difficultés à expliquer que pour le moment, en Belgique, la prévalence est suffisamment faible pour ne pas examiner tout le monde avec ces masques ffp2. Oui, je sens plus de peur au sein de l’hôpital qu’au début de l’épidémie.
Jean- Louis, Lamboray, comment réagissent les citoyens de Grez-Doiceau quand vous communiquez via Facebook ? L’anxiété est-elle aussi perceptible ?
 JLL : Je ne communique pas via la presse et donc c’est très différent. On pourrait parler de l’importance relative de la peur dans le changement de comportement. Est-elle une façon judicieuse de stimuler ce changement ? Personnellement, depuis mon expérience du sida, je dirais non.
JLL : Je ne communique pas via la presse et donc c’est très différent. On pourrait parler de l’importance relative de la peur dans le changement de comportement. Est-elle une façon judicieuse de stimuler ce changement ? Personnellement, depuis mon expérience du sida, je dirais non.
LB : Il faut passer de la peur à la confiance. J’ai l’impression que maintenant, on observe deux types de comportements. Les gens qui ont peur et ne veulent pas sortir. Ils sont incroyablement stressés et veulent quitter tout de suite l’hôpital pour rentrer dans leur bulle. Et puis ceux qui disent que tout va bien et relâchent complètement les efforts. Il est difficile de trouver un message pour ces deux publics.
On a beaucoup critiqué la communication des pouvoirs publics pendant cette épidémie. On est passé d’une communication très paternaliste voire infantilisante, assortie de menaces de sanctions à un langage plus axé sur la conscientisation. La communication, cela reste l’enjeu principal pour les prochains mois ?
YC : C’est capital et c’est même la clé du succès. Les autorités publiques doivent trouver une communication qui fonctionne et soit audible par le grand public. Le problème, c’est qu’il y a celle des experts et celle des autorités. Dès qu’on a démarré le déconfinement, on a senti une communication très différente entre les deux parties. Cela devient alors inaudible pour le public. C’est le politique qui devait reprendre la mainmise sur la communication, pas les experts. C’est encore le problème maintenant. On laisse trop la parole aux experts et les gens traduisent leur avis comme des recommandations politiques. Ce fut le cas pour le port du masque obligatoire. C’est parce que les experts ont tapé du poing sur la table que les politiques l’ont finalement imposé. Les experts n’auraient pas dû taper sur la table. C’était aux politiques de prendre cette mesure, si elle était nécessaire.
Avec le recul, quel est pour vous, que ce soit au niveau du confinement, comme du déconfinement, l’échec le plus évident ?
YC : Les maisons de repos. Malgré un confinement plus précoce, le virus s’est infiltré très facilement pour des tas de raisons : manque de matériel de protection, qualification du personnel. Ce qui s’est passé dans les maisons de repos était inévitable vu la situation de celles-ci avant la crise.
LB : Au niveau des hôpitaux, je vois surtout un énorme problème de communication. Pas assez de concertation, des décisions qui tombent plic ploc sans que l’on sache qui a décidé quoi, pourquoi et comment. Et surtout le manque d’anticipation, que ce soit avec les masques, les équipements, les tests… Je suis optimiste d’habitude mais là je ne le suis pas. Aujourd’hui encore, nous avons reçu une recommandation de la part du Conseil supérieur de la santé qui est en désaccord avec Sciensano et ne correspond pas à ce que nous faisons. D’où viennent ces recommandations qui sortent de nulle part ? On ne sait pas qui a décidé, quel médecin a été consulté. Durant cette crise, il y a eu trop d’organes décisionnels et sur le terrain, on ne savait plus qui décidait de quoi et pourquoi. J’ai l’impression que ce fonctionnement va se poursuivre. Il n’y a pas de fil conducteur dans la politique menée.

JLL : Pendant la première réunion en ligne de l’Agora de Grez-Doiceau, nous avions posé la question : comment vivons-nous le Covid ? Une première réaction était de dire que le confinement, c’était fantastique. On pédale dans la nature, on peut penser au sens de la vie, l’après Covid sera évidemment différent avec la reconnaissance de l’écologie, etc. Puis sont venus d’autres témoignages : « Je suis la mère de deux ados, je dois m’occuper du magasin qui est fermé, j’essaie de m’en sortir et mon mari bosse aussi à la maison et c’est l’enfer» . Un autre relevait qu’une part de l’économie s’envole, tout ce qui concerne le digital. Un troisième disait être réduit à la mendicité parce qu’il fait partie du secteur de la culture. Dans l’Agora, on a pu créer des liens entre ces différentes personnes. Il y a eu des solidarités mais, ce que nous ne sommes pas parvenus à faire, c’est parler du Covid. Que pouvons-nous faire, nous citoyens, dans cette situation ?
L’épidémie pose-t-elle un problème de « vivre ensemble » ? Dans certains pays d’Asie, la seconde vague de contamination suscite la stigmatisation des personnes malades et de leur entourage. On considère qu’elles sont responsables de leur état. Peut-on craindre chez nous aussi cette réaction qui ressemble fort à celle qui a prévalu au début de l’épidémie du sida où l’on considérait également que les personnes contaminées « l’avaient bien cherché » ?
JLL : En Thaïlande, quand j’ai ouvert le bureau régional d’Onusida pour l’Asie, des responsables m’ont dit : la première chose que nous avons faite, c’est d’arrêter les messages anxiogènes. Les Thaïlandais ont même été très loin dans la célébration de l’amour au sein de leur communication. Ils disaient : « Nous allons nous en sortir » et c’est, en effet, ce qui s’est passé. Ils ont réussi en distillant un message de confiance. On a vu alors que des personnes qui étaient au départ exclues de la société parce que c’était soi-disant « de leur faute », sont devenues actrices du changement dans la société. Des personnes porteuses du VIH ont été élues bourgmestres parce qu’elles avaient pris les choses en main.
Des clivages sont apparus. Les jeunes contre les vieux. Les jeunes accusés d’être insouciants et de contaminer les autres, les vieux, que l’on veut laisser confinés et qui sont jugés par certains responsables du confinement généralisé.
LB : On doit insister malgré tout sur le fait que les personnes âgées sont plus à risques que les autres. Obésité, âge, risques cardio-vasculaires, diabète… les chiffres sont là. Il faut protéger ces personnes et cela passe par une attitude responsable. Mais je sais aussi les dégâts que provoque la stigmatisation. Comme médecin, à part essayer de conscientiser les gens, je ne vois pas trop ce qu’on peut faire de plus.
Agir dans les lieux de vie des jeunes
Les communes ont joué un rôle important, notamment par la distribution des masques. En ont-elles aussi pour maintenir la cohésion sociale et comment voyez-vous leurs responsabilités pour les prochains mois ?
 YC : Oui, les communes ont un rôle important à jouer. On avait même imaginé que le suivi des contacts puisse se faire au niveau communal, pour assurer la confiance dans la nécessité de retracer les contacts. Cela n’a pas été suivi par les décideurs, mais je pense que la commune a une flexibilité et surtout une connaissance contextuelle très importante pour les problèmes post-Covid.
YC : Oui, les communes ont un rôle important à jouer. On avait même imaginé que le suivi des contacts puisse se faire au niveau communal, pour assurer la confiance dans la nécessité de retracer les contacts. Cela n’a pas été suivi par les décideurs, mais je pense que la commune a une flexibilité et surtout une connaissance contextuelle très importante pour les problèmes post-Covid.
LB : Je ne sais pas si les jeunes, par contre, peuvent être touchés. Les ados se tournent-ils spontanément vers les informations communales ? Il faut intervenir à un niveau plus proche encore, la famille, le médecin traitant.
YC : Il faut agir au niveau des lieux de vie des jeunes : les salles de sport, les mouvements de jeunesse, partout où les jeunes se retrouvent. Et il faut adapter le message.
JLL : La commune de Grez-Doiceau a soutenu un effort d’auto-évaluation des pratiques individuelles pendant le confinement. Il y a eu 400 auto-évaluations dans la commune et on a pu voir quelles étaient les pratiques qui posaient problème : le masque, ne pas toucher le visage… On peut imaginer que les autorités communales adaptent leur communication par rapport à ces pratiques. Au début de l’automne, il y aura un deuxième co-check adapté à la situation actuelle et qui insistera plus sur la conversation : je parle dans mon milieu de travail, je discute dans ma famille. Tout ceci part de la « foi » quant à la capacité des gens à se prendre en charge . La personne à risque est la première personne qui doit se prémunir, elle est capable d’altruisme comme les jeunes sont capables d’altruisme si on fait appel à celui-ci. Les communes belges pourraient suivre l’exemple des communes africaines où les gens s’assoient avec leur bourgmestre, le médecin, jeunes et vieux, avec cette question : que fait-on ?
Cela demande de revoir le lien avec les citoyens…
JLL : Cela demande une transformation, du rôle du politique qui ouvre l’espace pour la discussion, qui soutient l’action citoyenne et qui ne se limite pas à intégrer le citoyen dans l’action politique.
On suit pour le moment l’incidence des nouvelles infections par commune pour pouvoir organiser le confinement. Si on voyait plutôt les bonnes choses qui sont organisées dans les communes, tout ce qui est fait pour éviter ce lockdown ? C’est très différent comme message. Il faut un « lâcher prise » tant au niveau fédéral que communal. Être moins dans le contrôle mais reconnaître que tout dépend du changement de comportement des individus. Cela vaut pour le sida, le changement climatique, l’usage des drogues ou du Covid.
Imaginer un reconfinement partiel comme on l’a fait en Espagne ou en Allemagne, est-ce imaginable en Belgique où la densité est forte, les noyaux urbains proches les uns des autres. Pourrait-on reconfiner à l’échelle communale ?
YC : C’est tout à fait imaginable pour les communes plus à risques. On pourrait concevoir un reconfinement local à l’échelle de Molenbeek, Schaerbeek, là où les contaminations sont fortes actuellement. Cela risque d’ailleurs de se passer à Paris également. Mais auparavant, il faut un testing massif à l’échelle communale, c’est la phase intermédiaire avant de remettre les gens chez eux.
Ne pas trop compter sur le vaccin
Comment voyez-vous l’avenir ? ? Une journaliste du Soir évoquait la théorie de la sucette. Quand on veut convaincre un enfant de faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire, on lui promet, comme récompense, une sucette, un chocolat. Et pour nous, adultes, privés de festival, contraint de porter un masque au cinéma, notre sucette, écrivait-elle, ce sera le vaccin.
(rires)
Dit autrement : les gens ont-ils raison de croire que le vaccin va tout régler ?
 LB : Il faudra d’abord que les gens acceptent de se faire vacciner. Même chez les médecins, j’en connais qui se méfient du vaccin « Covid ». On n’a pas de boule de cristal. Pouvait-on imaginer qu’en juillet il y aurait à nouveau des clusters d’épidémie un peu partout en Europe ? Cette crise doit nous apprendre l’humilité, car finalement, on ne fait que naviguer à vue. Le vaccin, on ne sait pas quand il va arriver, quelle va être son efficacité, la durée de l’immunité. Je ne vois pas le vaccin comme quelque chose de miraculeux, mais plus comme un outil éventuel. Alors, pour l’instant, à part rester prudent tout en continuant à vivre, je ne vois pas trop ce qu’on peut faire de plus
LB : Il faudra d’abord que les gens acceptent de se faire vacciner. Même chez les médecins, j’en connais qui se méfient du vaccin « Covid ». On n’a pas de boule de cristal. Pouvait-on imaginer qu’en juillet il y aurait à nouveau des clusters d’épidémie un peu partout en Europe ? Cette crise doit nous apprendre l’humilité, car finalement, on ne fait que naviguer à vue. Le vaccin, on ne sait pas quand il va arriver, quelle va être son efficacité, la durée de l’immunité. Je ne vois pas le vaccin comme quelque chose de miraculeux, mais plus comme un outil éventuel. Alors, pour l’instant, à part rester prudent tout en continuant à vivre, je ne vois pas trop ce qu’on peut faire de plus
Donc, la seule perspective, c’est d’apprendre à vivre avec le virus ?
YC : Pour les mois qui viennent, malheureusement oui. On pensait que ce serait plus court mais ce ne sera pas le cas. Il faudra vivre avec ce virus et chaque fois réagir plus fort lorsque la situation sera moins sous contrôle. Cela n’empêchera pas de reprendre une vie normale.
Le vaccin, c’est pour l’épidémie suivante, je pense. Je ne me fierais donc pas au vaccin, mais par contre je me fierais à une adaptation du mode de vie pour essayer de le maintenir en bruit de fond. En espérant toujours que ce virus disparaisse à un moment donné. Il y a quand même toujours cet espoir. Comme le SRAS 21 qui a disparu.
JLL : Rappelons-nous qu’en 91, on prévoyait un vaccin pour le sida pour « dans les 15 ans ». On l’attend toujours. À l’époque, le délégué thaïlandais à l’OMS avait dit : « nous n’avons pas de vaccin médical mais nous avons le vaccin social ». Quels sont ses ingrédients ? Une communication claire et prédictive par les autorités politiques. Un système de soins public performant. La qualité de la concertation locale par les gens. Et enfin, la communication entre ces trois sphères. Il faut apprendre des épidémies passées.
LB : La communication est un mot-clé. Et ça ne va pas dans le bon sens. Voyez, pour les voyages, ces graphiques qui changeaient tout le temps. Cela donne une impression de déjà vu.
Vous êtes pessimiste ?
LB : Il faut vérifier tous les jours si des zones sont davantage à risque. On est plusieurs à se dire : « on se croirait en mars ». Pas par crainte de voir arriver plein de patients dans les hôpitaux, comme en mars, mais dans cette dynamique de contrôler les zones géographiques. Mais maintenant, nous pouvons tester…
JLL : Ce qui n’a pas eu lieu, c’est une vraie discussion entre les experts et notamment avec ceux qui ont géré les épidémies précédentes.
LB : Il est vrai qu’il aurait fallu intégrer plus de gens de terrain. Il y a un plan pandémie qui existe en Belgique. Or il n’a pas été activé.
JLL : Pourquoi ?
LB : Je ne sais pas. Il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont pris toutes les décisions et cela a été problématique. Je ne comprends pas pourquoi ce plan n’a pas été mis en route.
Or le Covid ne sera sans doute pas la dernière épidémie que notre pays devra gérer.
LB : En effet.
 JLL : Que l’on confine la population en disant : on n’a pas les moyens, pas de masque, pas de tests, on n’a pas investi dans ce domaine depuis des années… désolé, les gars vous restez à la maison et on s’organise. Soit. Mais après ? Est-il raisonnable de prendre comme indicateur le nombre de nouvelles infections ? Pour moi, il y a une très bonne nouvelle, qu’on n’annonce pas : le ratio nouvelles infections – hospitalisations est en train de dégringoler
JLL : Que l’on confine la population en disant : on n’a pas les moyens, pas de masque, pas de tests, on n’a pas investi dans ce domaine depuis des années… désolé, les gars vous restez à la maison et on s’organise. Soit. Mais après ? Est-il raisonnable de prendre comme indicateur le nombre de nouvelles infections ? Pour moi, il y a une très bonne nouvelle, qu’on n’annonce pas : le ratio nouvelles infections – hospitalisations est en train de dégringoler
LB : Je l’ai dit : le fait de rappeler les chiffres tous les jours, ça énerve, ça m’énerve. D’autant plus que dans les tests positifs, il y a ce qu’on appelle des « vieux Covid ». Le nombre de PCR positives est surévalué parce qu’il y a parmi ces personnes testées, des gens qui n’ont aucun symptôme, mais surtout qui en ont eu et pour lesquels la charge du virus est alors très faible. Par contre, ce qui est important, c’est le nombre d’hospitalisations.
JLL : Il y a un autre ratio qui n’est pas communiqué, c’est le ratio entre le nombre d’infections, qui augmentent, et le nombre de tests effectués. Il faut communiquer sur les proportions entre les deux. Et pas sur les chiffres absolus.
YC : On n’a pas grand-chose d’autre, comme indicateur à ce stade, sinon le nombre de cas. Tenir compte des hospitalisations, c’est trop tardif. Il faut des indicateurs plus en amont. Et pour le moment, on n’en pas beaucoup.
JLL : Si nous adoptons les mesures recommandées, est- ce vraiment un problème de constater que dans une école, le virus puisse se propager ?
LB : Le problème, c’est que les gens ne comprennent plus et ça, c’est problématique. Il est dommage par exemple de devoir imposer le masque dans les magasins alors que ce n’est pas compliqué d’adopter ce geste.
Cela pose une fois encore la question de l’adhésion de la population aux recommandations des autorités ?
LB : Oui. Parce qu’elles manquent de clarté.
Et comment garder cette adhésion ?
YC : Cela ne peut marcher que si on est cohérent. Mais c’est vrai, il y a des cas absurdes, comme les camps scouts où on sort les jeunes pour les tester, ils sont négatifs mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur « bulle » et doivent retourner chez eux. Il y a plein d’aberrations de ce genre et les gens ne comprennent plus rien. Le problème, avec cet exemple, c’est qu’à un moment donné, les gens ne vont plus vouloir se tester et vont passer à côté du système parce qu’il y a trop d’ « injustices ».
JLL : On nous avait dit que, selon les modèles des experts, il fallait s’attendre à une augmentation significative des cas après la première phase de déconfinement. Et puis ces experts nous ont dit : « Nous sommes très étonnés, il ne se passe rien ». Ils ont dit : « Attendez la phase suivante, cela va augmenter ». Et à nouveau, ils ont été très étonnés.
YC : C’est tout le problème des modèles. On savait que l’épidémie allait stagner un bout de temps, on savait le nombre de morts possible. Mais il est vrai que pour les différentes phases du déconfinement, nos modèles avaient montré des variations, que nous n’avons pas constatées.
JLL : Il faudrait tout de même avoir une vue sur l’efficacité de chacune des mesures prises. Or elles ne nous sont pas connues.
YC : Non en effet. On les analyse rétrospectivement. La cible bouge. Aujourd’hui, ce sont surtout les moins de 40 ans qui sont atteints par le virus. Donc, nos modèles et les mesures à prendre doivent s’adapter.


Intéressant e mise au point par l’approche d’expertise de terrain différentes.
A titre petso, je remarque que bcp o.t confondu déconfinement et fin de pandémie.
Reláchement même chez les ainés.
Nous vivons dans un monde qui exige le « risque zéro »,qui réclame que les gouvernants l’assure, les assureurs l’assurent, les militaires , les pompiers,les médecins,les chiens d’aveugles….bref « les autres ». Que chacun assume sa part de précautions (et puisse « vivre ») dans un milieu où covid 19 sera, qu’on le veuille ou non, endémique.
Le respect de l’autre est une base de fonctionnement….mais nous ne sommes pas Suédois,et sous notre latitude c’est devenu une denrée rare
Merci pour cette interview et son compte-rendu. Elle donne un éclairage nuancé, sous différents angles. J’apprécie qu’elle souligne la responsabilité citoyenne et reconnaisse toute l’incertitude et la nécessité de s’adapter. Il me semble important que la locale Ecolo ait abordé cette réalité.